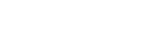Julien Durieux
La nature est un temple où de vivants piliers…
L’énorme globe oculaire de la Lune s’est posé dans une gerbe d’étincelles. Lorsqu’il fait beau ce sont des vols de guêpes, des mouvements d’étourneaux, des pluies d’étoiles qui se perdent dans les eaux, la course continue de mille météorites. Lorsque le froid pénètre ce sont des poudroiements, des ciels informatiques où tout n’est plus que chiffres, algèbre des nuages ; les frimas cheminent et laissent sur les terres durcies et le ciel de Pannonie la marque de leurs chenillettes. Vides apparemment, les paysages sont tous des lieux investis, habités, en résonance sympathique. Tout est ici sous le signe d’un regard familier, observateur, lucide et amoureux du tranchant de lame de la Tisza, de son coude blanchi, des foisonnements de photons catapultés sur la quenouille des marais, des courbes sensuelles de collines patinées à la verte fraîcheur des paysages de Dürer.
Derrière ces bâtonnets, façon Van Gogh, ces virgules, ces entrelacs, ce pointillisme à la Signac, on pourrait se demander „qu’est-ce qui se trame ?”. La nuit a éclaté, le jour a éclaté, le fleuve est frappé dans sa masse. Tout vibre, tout s’inscrit comme dans une chambre de Wilson sous un rayonnement continu, un bombardement permanent qui transforme les paysages connus en estampes intemporelles, en décors hiératiques, en impression façon tweed qui dérobent et révèlent en même temps les lignes essentielles.
Curieusement, ce regard est capable de tout : il est à ras de l’horizon pour suivre le fleuve, il vole de nuit au-dessus de l’empiècement des collines, il est à la verticale des îles, loin des versants dont il dessine la coquille au soleil, près des roseaux et de leur enchevêtrement, et même de force à transposer ce réel abouti, en fumées passagères, en plaques juxtaposées comme un puzzle, en collages de signes abstraits où triomphe la relation charnelle à ces lignes profondes.
Paris, 14 février 2002.